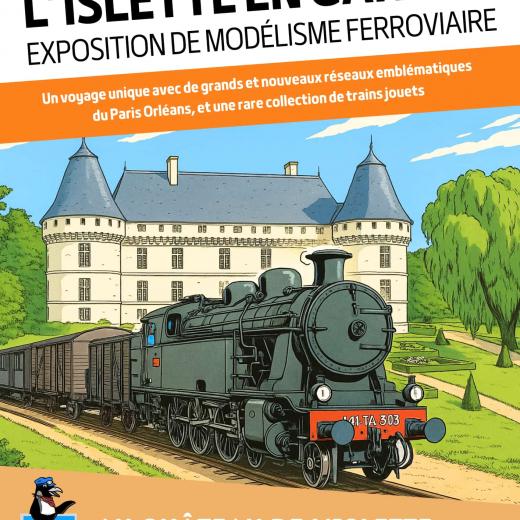Informations Pratiques
Superficie
14 hectares
Horaires
Du 4 au 30 avril et du 1er octobre au 1er novembre : 11h - 17h30
Du 1er mai au 30 juin et septembre : 10h30 - 18h
Juillet-août : 10h - 19h
Tarifs
Adultes : 12€
Tarif réduit : 7€50
étudiants de moins de 25 ans sur présentation de leur carte, titulaires d’une carte d’invalidité ou personnes âgées ne pouvant visiter le 1er étage, habitants d'Azay-le-Rideau et de Cheillé sur présentation d'un justificatif de domicile
Jeunes de 18 à 25 ans : 10€
Gratuit : enfants de - 7 ans
Pour réserver une visite, merci d'adresser un mail à info@chateaudelislette.fr ou au moyen du formulaire de contact
Site web
Adresse
Téléphone
Les Plus
Circuit
- Monument Historique
Au cœur de la Touraine, dans un cadre séduisant où se mêlent harmonieusement la blancheur délicate du tuffeau et le vert toujours changeant de l'Indre, le château Renaissance de l'Islette, enserré par les bras de l'Indre, rappelle celui d'Azay-le-Rideau. Le site est une invitation à se laisser emporter par le charme si romantique de la Vallée de l'Indre. Le nom de « l’Islette », petite île, évoque bien sûr la présence de l’eau, élément indissociable de la beauté du lieu. Parc à l'anglaise dessiné et planté vers 1830, création récente d'un jardin structuré et arbres centenaires participent à l'harmonie du lieu. Le château commandé par René de Maillé est achevé vers 1530. L’Islette abrita, au cours des années 1890, les amours des deux grands sculpteurs Camille Claudel et Auguste Rodin. Si le château vibre toujours au souvenir de leur présence, il est aujourd'hui habité par ses actuels propriétaires, et par conséquent, aménagé en lieu de vie.
Superficie : 14 hectares
Passé un portail daté de 1638, cantonné de deux pavillons carrés, le château se trouve dans un lieu privilégié sur la rive gauche de l’Indre. Un pont traverse le bras principal, laissant voir sur la gauche l’ancien moulin qui répartit les eaux. Le nom de « l’Islette », petite île, évoque bien sûr la présence de l’eau, élément indissociable de la beauté du lieu, reflet des pierres, du feuillage et du ciel. Ce nom prend tout son sens avec l’Indre qui traverse le domaine, s’étire et serpente, donnant à l’ensemble un charme incomparable. L’agrément procède aussi des arbres centenaires qui enserrent le château : allée de platanes, noyer d’Amérique, tilleuls, marronniers... Le parc à l’anglaise, dessiné et planté vers les années 1830, forme un écrin qui participe à l’harmonie d’ensemble du lieu. Un jardin structuré répond à l’admirable façade sud du monument. Les lignes, qui délimitent les carrés de rosiers, ne se veulent cependant pas trop strictes ; les saules nains leurs apportent une douceur et une fluidité en continuité avec la nature environnante.
Au total, ce sont 14 hectares autour d’un kilomètre de rivière qui invitent à la promenade, à la flânerie ou à la rêverie.
Le château commandé par René de Maillé est achevé vers 1530. Ce long corps de logis rectangulaire à trois étages, flanqué de deux imposantes tours, rappelle celui d’Azay-le-Rideau par sa conception architecturale et sa situation sur les eaux. La tradition veut d’ailleurs que les ouvriers d’Azay aient construit l’Islette. On y retrouve le même double corps de moulures entre deux étages, des fenêtres à meneaux de mêmes proportions ornées d’une volute au centre du linteau, le même couronnement par un chemin de ronde sur mâchicoulis. La porte d’entrée principale, ancien pont-levis dont il subsiste les rainures, est surmontée d’un cartouche finement sculpté présentant le blason des Barjot de Roncée que soutiennent de charmants angelots Renaissance. Au rez-de-chaussée de la tour Est, la chapelle à ogives, entièrement restaurée, laisse apparaître des peintures murales et une voûte avec semis d’étoiles. Une fois passé la salle de garde, un large escalier en vis de pierre mène au premier, « l’étage noble ».
Le château, habité par ses actuels propriétaires, est donc aménagé en lieu de vie.
L’Islette abrita, au cours des années 1890, les amours des deux grands sculpteurs Camille Claudel et Auguste Rodin. Le château vibre toujours au souvenir de leur présence.
« Vous ne pouvez vous figurer comme il fait bon à l’Islette… et c’est si joli là ! … Si vous êtes gentil à tenir votre promesse, nous connaîtrons le paradis. » (Camille Claudel à Rodin)
Lieu de création et source d’inspiration, Rodin y travailla à son fameux Balzac, dont la statue lui fut commandée par la Société des Gens de Lettres en août 1891.
« Monsieur Rodin, Vous me faites demander … de vous écrire mon avis sur votre statue de Balzac : je la trouve très grande et très belle et la mieux entre toutes vos esquisses du même sujet … En somme je crois que vous devez vous attendre à un grand succès surtout près des vrais connaisseurs qui ne peuvent trouver aucune comparaison entre cette statue et toutes celles dont jusqu’à présent on a orné la ville de Paris. » (Camille Claudel)
Quant à Camille Claudel, elle y sculpta l’une de ses œuvres majeures : La Petite Châtelaine, prenant pour modèle la petite-fille des propriétaires du château à l’époque. De ce buste, Camille Claudel exécuta quatre versions qui diffèrent par la chevelure.
« Il y a … dans la disproportion même de cette tête déjà trop puissante, déjà trop vivante, déjà trop ouverte sur les mystères éternels et les épaules délicatement puériles qu’elle découvre, quelque chose d’indéfinissable qui communique une angoisse profonde … Le buste prouve … que Mlle Camille Claudel est désormais un maître … » (Mathias Morhardt).
Chronologie :
1295 : l’Islette, fief dépendant de l’Île-Bouchard, appartenait à Jean Pannetier, Bailli de Touraine. Puis la famille de Maillé posséda le domaine pendant trois siècles, de 1350 à 1650. Il passa ensuite dans les familles Tiercelin d’Appelvoisin et Barjot de Roncée.
De Rivarennes, en juillet 1769, Beaumarchais écrivait à sa femme : « A travers les arbres dans le lointain, je vois le cours tortueux de l’Indre et un château antique flanqué de tourelles qui appartient à ma voisine Mme de Roncée ».
A l’époque de la Révolution, le château appartenait à Charles Tiercelin d’Apelvoisin, député aux Etats généraux de 1789 et qui mourut sur l’échafaud en 1793.
Vendu sous le Premier Empire, plusieurs propriétaires se succédèrent au 19ème siècle.
Vers 1890, Camille Claudel et Rodin séjournèrent à plusieurs reprises au château de l’Islette.
L’Islette fût classé Monument Historique par arrêté du 15 novembre 1946.
Au milieu des années 60, le château fit l'objet, par Pierre et Madeleine Michaud, parents les actuels propriétaires, d'une importante campagne de restauration.
2010 : ouverture au public.
Services
La visite s’effectue librement au moyen d'une application mobile iOS et Androïd très complète à télécharger sur votre store habituel ou à l’aide d’une brochure de visite en 10 langues (français, anglais, allemand, néerlandais, italien, espagnol, portugais, russe, japonais, chinois).
Les chiens sont volontiers acceptés à l’Islette. Cependant, ils doivent être en permanence tenus en laisse dans le parc. Quant à l’intérieur du château, seuls sont admis les plus petits s’ils sont portés dans les bras de leurs maîtres ou dans un panier.
Location de barques :
Louez une barque, promenez-vous sur l’Indre (1km) et découvrez l’Islette autrement. Pour votre sécurité, et afin que la balade reste un plaisir et une détente, cette activité n’est réalisable que lorsque le courant de la rivière et les conditions météorologiques le permettent.
Tarif : 6 € la demi-heure pour une barque (4 personnes par barque au maximum).
Pique-nique :
Il est possible de pique-niquer à l’intérieur de la propriété, au bord de l’eau… L’accueil vous indiquera les lieux où vous pourrez vous installer. Des tables sont disponibles en bordure de rivière ou près de l’aire de jeux, mais il est conseillé d’apporter un tissu pour déjeuner sur l’herbe ou à l’ombre d’un arbre.
En cas de pluie, un bâtiment de la ferme vous servira d’abri.
Si vous n’amenez pas votre panier, vous pourrez composer votre repas à la boutique, en particulier avec des produits locaux.
Boutique
Située au rez-de-chaussée de l’ancien moulin, vous y sont trouverez notamment une sélection de livres et souvenirs sur l’Islette et sur Camille Claudel et Rodin.
Buvette
Procurez-vous une boisson chaude ou fraîche dans la boutique et installez-vous à l’une des tables placées autour du moulin. Un salon, avec un feu dans la cheminée s’il fait un peu frais, est également à votre disposition.
Prêt de livres -
Dans la boutique, empruntez un ouvrage et faites une pause pour mieux vous documenter sur Camille Claudel, Rodin ou les châteaux de la Loire.
Une pièce d’identité vous sera demandée pendant la durée du prêt.
Prêt de kits d'observation -
Empruntez l’un des quatre kits d’observation composés d’une paire de jumelles de qualité et d’un ouvrage sur les oiseaux et partez à la découverte des mésanges, rouges-gorges et autres habitants des arbres, mais aussi des canards, des poules d’eau ou des ragondins sur ou autour de la rivière.
Un kit par famille. Durée : 2 heures.
Une pièce d’identité vous sera demandée pendant la durée du prêt.
Transats -
Et au final, détendez-vous dans un des transats disposés le long de la rivière et profitez des instants de quiétude que vous offre l’Islette…